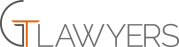Les États‑Unis disposent du « 15 U.S. Code Chapter 20 » ; l’Angleterre, de l’« Insurance Act 2015 » ; et la France, du « Code des assurances ». S’inscrivant dans la tendance internationale, le Brésil a consolidé la réglementation de l’assurance dans une législation propre. Le 9 décembre 2024, a été promulguée la Loi n° 15.040, connue sous le nom de « Cadre légal des assurances », qui abroge des dispositions du Code civil de 2002 et introduit de nouveaux préceptes pour le secteur.
Bien que novatrice, cette législation intervient sur un marché de l’assurance robuste. En février 2025, la Superintendência de Seguros Privados (Susep) a publié un rapport indiquant qu’en 2024, les recettes des segments assurance, prévoyance et capitalisation ont totalisé 435,56 milliards R$, soit une croissance de 12,2 % par rapport à l’année précédente. Mais, au juste, qu’est‑ce qui change réellement avec le nouveau cadre ?
Le Code civil de 2002 traitait le sujet en seulement 46 articles — 45 consacrés au contrat et un à la prescription. Le nouveau Cadre légal élargit considérablement ce corpus, passant à 134 articles, remplaçant des dispositions obsolètes et introduisant des innovations pertinentes. Compte tenu de cet ample périmètre, voici quelques‑unes des principales nouveautés.
Interprétation des contrats : nouvelle protection de l’assuré
Pour la première fois, la législation brésilienne établit des règles objectives d’interprétation des contrats d’assurance, afin de garantir davantage de transparence. L’essor du marché suppose que les instruments contractuels soient accessibles et compréhensibles par le public. Désormais, les risques et intérêts doivent être décrits « de manière claire et univoque », la rédaction la plus favorable à l’assuré prévalant en cas de divergence entre police, modèle contractuel ou notes techniques (art. 9, paragraphes 1 et 2). En outre, les supports publicitaires et les instruments précontractuels doivent également être interprétés en faveur de l’assuré (art. 57).
Communication de l’aggravation du risque : obligation renforcée
L’article 14 du nouveau cadre détaille l’obligation pour l’assuré de communiquer immédiatement à l’assureur toute aggravation substantielle du risque. L’assuré doit, par conséquent, notifier l’assureur en temps utile, renforçant une obligation déjà prévue auparavant. Le délai de délibération de l’assureur est porté à 20 jours, permettant d’exiger une prime additionnelle ou la résiliation du contrat, si le risque accru ne peut être garanti. En cas de résiliation, celle‑ci doit intervenir dans les 30 jours, l’assureur pouvant retenir proportionnellement certains coûts lors de la restitution de la prime.
Le Code civil prévoyait déjà cette communication, sous peine de perte de la couverture en cas de mauvaise foi. À présent, le nouveau cadre durcit les conséquences : l’omission dolosive peut entraîner, outre la perte de la garantie, l’obligation de payer la prime et de rembourser les frais. Il prévoit en outre des effets spécifiques en cas d’omission fautive, à définir par la jurisprudence.
Comportement de l’assuré face au sinistre : « duty to mitigate the loss »
Le nouveau Cadre légal, à son article 66, actualise le comportement attendu de l’assuré face à un événement couvert. Dès la connaissance du sinistre ou de son imminence, l’assuré a le devoir d’informer promptement l’assureur par tout moyen approprié et de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ou minimiser les dommages, consacrant au Brésil le principe international connu sous le nom de « duty to mitigate the loss ».
Il incombe en outre à l’assuré de fournir toutes les informations disponibles sur le sinistre, ses causes et ses conséquences, chaque fois qu’il en est requis. Le manquement dolosif à ces obligations — c’est‑à‑dire avec l’intention de nuire ou d’omettre des informations pertinentes — entraîne la perte totale du droit à l’indemnisation ou au capital assuré, sans préjudice de la perception de la prime et du remboursement des dépenses supportées par l’assureur. Si le manquement n’est que fautif, l’assuré perd le droit à l’indemnisation à hauteur seulement des préjudices résultant de l’omission.
La législation prévoit également des atténuations : si l’assureur prouve avoir pris connaissance en temps utile du sinistre ou d’informations pertinentes par d’autres moyens, même sans la communication formelle de l’assuré, les sanctions peuvent être écartées. Il est important de souligner que le bénéficiaire est également soumis à ces obligations et pénalités lorsqu’il est partie intéressée.
Régulation et liquidation des sinistres : célérité et transparence
S’agissant de la conduite du sinistre, la gestion et la liquidation demeurent de la responsabilité exclusive de l’assureur, qui peut désigner son propre expert en sinistres sans déléguer la décision finale. Les articles 76 et 77 recommandent, lorsque cela est possible, de mener simultanément les phases de régulation et de liquidation, afin de favoriser une plus grande rapidité du processus. Le rapport généré devient un document commun aux parties et, en cas de refus de couverture, tous les documents ayant fondé la décision de l’assureur doivent être mis à la disposition de l’intéressé. Le délai de réponse est de 30 jours, prorogeable dans les situations complexes, pouvant atteindre 120 jours.
Délais pour la revendication des droits
Le nouveau cadre innove également quant aux délais pour revendiquer des droits liés au contrat d’assurance. L’article 126, I, fixe, en principe, un délai d’un an à compter de la connaissance du fait générateur pour que les assureurs recouvrent les primes, que les intermédiaires ajustent les rémunérations et pour les demandes entre assureurs et réassureurs. L’assuré dispose également d’un an pour réclamer l’indemnisation ou la restitution de la prime, à compter de la réception du refus formel. Pour les bénéficiaires et les tiers lésés, le délai est de trois ans à compter de la connaissance du fait générateur pour faire valoir leurs droits auprès de l’assureur.
Les adaptations introduites par le Cadre légal des assurances représentent une restructuration significative, améliorant la transparence, la rapidité et la sécurité juridique du secteur. Avec ses 134 articles, la loi marque un tournant vers la consolidation normative et l’alignement avec les pratiques de marchés plus matures, préparant le Brésil à un nouveau paysage dans le segment des assurances.
Enfin, il convient de souligner que, bien que promulguée en décembre 2024, la Loi n° 15.040 n’est pas encore pleinement en vigueur. Le secteur traverse une période de transition, dans l’attente du début de son application — prévu pour décembre 2025. D’ici là, assureurs, consommateurs et régulateurs cherchent à s’adapter et à observer la manière dont les nouvelles règles seront interprétées et mises en œuvre, tandis que le marché se prépare à ce nouveau cadre normatif.